
En mai 1968, les affiches ont sans doute été moins nombreuses que les tracts, mais elles ont été incontestablement un support plus efficace des provocations étudiantes. En effet, les affiches peuvent être considérées à bien des égards, comme une sorte de « journal mural » [1] qui invite au débat public en interpellant ceux ou celles qui les regardent. Ayant de facto vocation à toucher un plus grand nombre de personnes qu’un tract, les affiches par leur aspect artistique et par le message qu’elles véhiculent révèlent l’état d’esprit de ceux qui les ont conçues. D’autre part, l’affiche vient combler le côté austère du tract et correspond mieux de ce fait aux réalités étudiantes du mouvement de mai. Les affiches qui fleurissent alors sur les murs de la faculté des Lettres [2] témoignent d’une dimension festive et ludique inhérente au mouvement de remise en cause de la société entrepris par les étudiants. A partir du moment où la dérision, l’humour et l’insolence viennent briser la monotonie du discours technocratique et politique, les étudiants franchissent le cap de la simple contestation et se servent de l’affiche comme d’un instrument corrosif à des fins provocatrices. Trois types d’affiches réalisées par les étudiants nancéiens [3] ont pu être distingués en fonction de critères liés à leur composition et à leur contenu.
Les « affiches slogans » sont le support d’un message court, qui est censé interpeller le passant, qu’il soit enseignant ou étudiant, c’est le cas par exemple de cette affiche où l’on peut lire « Laissez tomber vos cours ! Pour une fois déridez-vous ! ». Ces affiches ne sont pas quantitativement parlant les plus nombreuses, dans la mesure où ce type de slogan est souvent écrit à même le mur, sans avoir recours préalablement au support papier [4]. D’autre part, ces affiches reprennent des slogans étudiants nationaux et ne témoignent pas d’une grande originalité vis-à-vis du mouvement parisien.
Le second type d’affiches présent à Nancy en mai 1968 est constitué d’ « affiches textes » ; il s’agit en fait d’affiches qui servent de support à la reproduction d’un texte de nature historique, comme le passage d’un ouvrage de Lénine ou bien de textes écrits par des militants d’organisations gauchistes qui remettent en cause les valeurs de la société de consommation par le biais d’une réflexion plus ou moins poussée. Ce type d’affiche laisse souvent la place à l’imagination des étudiants qui peuvent condenser sur un support mural leur mécontentement envers une société considérée comme sclérosée. Une affiche de ce type peut-elle pour autant être considérée comme une provocation ? Dans le cas étudié à présent, nous pouvons répondre par l’affirmative. Il s’agit ici d’une affiche placardée sur les murs de la faculté des lettres ayant pour titre : « La Commune n’est pas morte ». En dessous du titre, on peut lire le passage suivant : « La Commune est la première tentative pour briser la machine d’Etat bourgeoise ; elle est pour la révolution prolétarienne, la forme politique enfin trouvée par quoi l’on peut et l’on doit remplacer ce qui a été brisé » [5]. L’auteur de cette affiche a voulu clairement montrer que les événements de mai 1968 s’inscrivaient dans une dimension historique et qu’ils avaient pour but de remplacer par leur intensité et leur dimension nationale un État jugé obsolète par une forme plus moderne de gouvernance, censée être incarnée par une nouvelle Commune. La provocation repose ici sur une comparaison entre la volonté de changement politique et social exprimée par les étudiants et la Commune de Paris, qui est ici utilisée comme un référent culturel. Par delà les révolutions russes de 1917, les jeunes doivent puiser l’inspiration de leur combat dans l’histoire nationale et se muer ainsi en nouveaux communards. S’il est dans l’ensemble difficile de mesurer l’impact d’une affiche en tant qu’élément mobilisateur ou non des étudiants, nous pouvons néanmoins dire que celle-ci a été au moins ressentie comme une provocation par une personne, celle qui est venue y surimposer, sans doute à une heure tardive, ces quelques mots : « Galliffet non plus !! Vive Thiers ! ». La simple évocation du général Galliffet, qui montra une rigueur extrême dans la répression de la Commune, et d’Adolphe Thiers, chef du pouvoir exécutif de la République française en 1871, qui avait refusé de négocier avec les communards, rappelle d’une part aux étudiants contestataires, que leur opinion n’est pas partagée par tous leurs condisciples et d’autre part, que leur affiche a réussi à attirer l’attention de quelques-uns, puisque l’un d’entre eux a répondu au stimulus provocateur. Ceci soulève la question de savoir si une provocation qui n’engendre aucune réponse peut être considérée comme une véritable provocation. Le provocateur n’existe en lui-même et in fine que par l’accueil qui est donné à son acte. Une provocation qui ne connaît pas de réponse ou qui ne choque personne est soit une provocation ratée, soit un acte qui ne remet pas en cause une norme sociale et qui ne heurte donc pas ses contemporains puisqu’aucune réponse ne lui est apportée.
La plupart des affiches-texte portent l’estocade contre les normes en vigueur dans la société et expriment la rancœur et le mal-être de leurs concepteurs. Sous la forme d’une interrogation ou de remarques acerbes contre des valeurs qu’ils rejettent, elles témoignent par là de ce « festival de la parole agissante » [6] que fut mai 1968. Ces affiches mettent en lumière cette rupture générationnelle sans précédent qui est inhérente au mouvement étudiant. Les textes ainsi affichés entendent briser les tabous, les convenances et les interdits de l’époque. L’ennui et le vide d’une existence sociale insignifiante constituent l’arrière-fond du tableau. Cette réflexion d’un étudiant a retenu notre attention car elle s’inscrit dans une tendance nationale qui place le sexe et le discours produit sur le sexe au centre du problème dont souffrirait alors la société française : « Nos rues et nos boulevards ont deux niveaux comme deux courants superposés et contradictoires qui circulent parallèlement, sans même se frôler. Il y a le niveau des têtes, espèces de mornes cacahuètes apoplectiques ou osseuses ; et en dessous le niveau des cuisses, des hanches et des fesses qui semble avoir drainé tout dynamisme et tout mouvement. Le niveau supérieur est aveugle, sourd, mécanique. C’est le niveau inférieur qui observe, qui écoute, qui s’arrête, qui rêve, qui espère. Tant que l’œil s’attarde au premier niveau, il n’a dans son champ qu’une longue éruption de fatigue et d’indifférence ; s’il descend au deuxième niveau, il entre dans un monde vivant. Les cuisses déverrouillées d’une jolie fille qui sort de sa voiture…c’est la seule chose qui puisse encore allumer un semblant d’ardeur chez nos contemporains ». L’auteur de cette affiche pose clairement le problème auquel est confronté la société comme un enjeu sexuel et non spirituel, puisque les esprits ne sont pour lui que de « mornes cacahuètes apoplectiques et osseuses ». Il n’y a donc plus rien à attendre de l’esprit, alors que le niveau inférieur du corps humain concentre toutes ses attentions, car celui-ci est porteur d’espoir, de plaisir et de nouveautés. En d’autres termes, la révolution politique passe par une révolution sexuelle. Partant de ce principe, chaque étudiant est amené à proclamer sa sexualité et ses désirs. La sexualité devient donc un élément constitutif de la dialectique étudiante, volontiers provocateur au vu des us et coutumes des années soixante. Les références au sexe sont utilisées dans cette affiche afin de faire prendre conscience aux étudiants du décalage entre la réalité de leur vie quotidienne et la conception que s’en font leurs aînés. L’objectif étant de provoquer un choc chez le lecteur et une prise de conscience de la nécessité d’un changement politique radical. Cette prise de conscience devant se traduire par un engagement militant, c’est en ce sens que nous pouvons dire que la provocation est instrumentalisée afin d’entraîner l’adhésion sans ambages de celui qui en est la victime ou le complice. Se sentant directement concernés par cette réflexion, les jeunes doivent mettre en œuvre leur propre révolution culturelle.
Enfin, une troisième catégorie d’affiches regroupe toutes celles qui ont été dessinées par leurs auteurs. Le dessin est souvent utilisé comme un instrument servant à parodier la réalité et à remettre en cause par exemple le système universitaire. Il peut s’agir d’une critique à l’encontre du doyen, des enseignants ou bien ces affiches peuvent se concentrer sur un enseignant surtout si celui-ci est jugé réactionnaire et peu enclin au dialogue avec les jeunes générations. Ainsi l’une d’entre elles (illustration 1) est présentée sous la forme d’une publicité qui propose de se servir du doyen Schneider [7] comme d’un poste de télévision pour préparer ses examens : « Adoptez le télé-réviseur Schneider - Le seul qui vous permet d’obtenir des diplômes pas chers ». Cette affiche correspond à une période de radicalisation du mouvement étudiant nancéien (fin mai-début juin 1968) dû à la présence d’une petite dizaine d’agitateurs parisiens sur le site de la faculté des Lettres. Le 29 mai, quatre ou cinq étudiants membres du Groupe de liaison des étudiants marxistes installent une table à l’entrée de la faculté, à proximité du local de l’appariteur, avec une banderole sur laquelle on peut lire « Occupation de la fac de Lettres ». Cette initiative prend aussitôt chez les étudiants, qui avaient investi la veille
De la provocation à la dérision : la figure de l’ « ennemi » gaulliste ?
Dans la journée du 21 juin 1968, une multitude de petites affiches fleurissent sur les murs de la faculté des Lettres (illustration 3). Celles-ci prennent toutes pour cible un certain Monsieur Vax, maître-assistant dans ladite faculté, bien connu des étudiants pour ses sympathies gaullistes. Ces affiches sont composées de dessins sommaires et de jeux de mots faciles autour du nom de « Vax ». Ces dessins et ces slogans prennent l’apparence de publicités et ont été placardées suite à une escarmouche entre le jeune enseignant gaulliste et des étudiants. En effet, la nuit précédente, M. Vax aidé par trois de ses collègues, a mené une action commando dans les locaux de
Ces affiches qui se moquaient ouvertement de M. Vax ont-elles atteint leur objectif, à savoir provoquer chez lui un sentiment de vexation prononcé ? Force est de constater que ce dernier fut plutôt bon joueur puisque quelques jours après les événements, il entreprend une discussion avec les étudiants et affirme même que leurs affiches manquent de « mordant » et qu’« il aurait fallu être plus rosse ». Quant aux différentes publicités réalisées à partir de son nom et notamment celle qui s’intitulait « Lavax », le jeune enseignant reconnaît volontiers : « Il y a longtemps que j’avais remarqué que j’avais un nom pour détersif » [13]. Si la provocation de M. Vax n’avait pas fonctionné, elle provoqua chez le principal intéressé un sentiment d’autodérision et dans la communauté étudiante des éclats de rire généralisés.
Les différentes formes de provocations étudiées précédemment et leurs supports respectifs permettent de nuancer leur impact réel sur le monde étudiant nancéien. Si la contestation peut être perçue comme « la langue privilégiée de mai 68 » [15], il ne peut pas en être considéré ainsi des provocations. Certes, celles-ci n’ont pas été absentes, mais elles sont finalement partagées par une minorité d’étudiants. En ce sens, les quelques agitateurs parisiens présents à la faculté des Lettres sont des professionnels de la provocation, mais ils sont avant tout des militants d’organisations politiques et des orateurs qui savent conditionner leur auditoire. La distinction entre l’agitateur et le provocateur se cristallise autour de ces deux axes : d’une part le degré de politisation et d’autre part, la fréquence d’exercice du provocateur, qui est plus occasionnelle que celle de l’agitateur. Au vu de la modération des étudiants nancéiens et du faible taux d’adhésion en faveur des idées et des méthodes des groupuscules gauchistes, les provocateurs ont été marginalisés par rapport à l’ensemble des manifestants. Enfin, la provocation n’a pas été utilisée ici comme un instrument revendicatif mais subversif, à l’inverse des contestations et protestations en tous genres. La provocation a soit été un stade ultime, traduisant un désespoir de cause de certains étudiants, un point de non retour ; soit le stade initial de la contestation, permettant de lancer un mécanisme contestataire et d’enclencher la mobilisation étudiante.
Prochains épisodes sur Mai 68 à Nancy :
- 1. Mars 1968 à Nancy : les prémices de mai ? (J. Pozzi)
- 2. Les tracts de mai : des vecteurs d’une provocation ciblée (J. Pozzi).
- 3. Les lycées en ébullition
- 4. Les affiches : le vecteur privilégié des provocations étudiantes (J. Pozzi)
- 5. La parole se libère à la salle Poirel, "l'Odéon" lorrain (témoignage et documents)
- 6. Des photographies inédites (Fac de médecine, Salle Poirel,...) (J.-L. Wagler)
- 7. Retour à la normale...
- 68 raconté à mes petits-enfants (1) Découverte de la politique et engagement (Guy Charoy)
- 68 raconté à mes petits-enfants (2) Dans la "vie active" (Guy Charoy)
- 68 raconté à mes petits-enfants (3) Solitude et barbouille (Guy Charoy)
- 68 raconté à mes petits-enfants (4) Pendant ce temps... UEC et UJC (ML) (Guy Charoy)
- 68 raconté à mes petits-enfants (5) Garde Rouge à Nancy (Guy Charoy)
- 68 raconté à mes petits-enfants (6) Théorie Pratique Théorie (Guy Charoy)
- 68 raconté à mes petits-enfants (7) Manif' minimale (Guy Charoy)
- .....
[1] Marie-Claire Lavabre, Henri Rey, Les mouvements de 1968, Casterman-Giunti, 1998, pp. 53-55.
[2] Ces affiches utilisent souvent pour la première fois la technique de la sérigraphie et sont réalisées par les étudiants de l’Ecole des Beaux-Arts de Nancy.
[3] Fonds Mai 68 constitué par Gérard Thirion, alors conservateur à la bibliothèque, archives de
[4] Un certain nombre de slogans écrits sur les murs ou sur des affiches à Paris ont été rassemblés dans : Julien Besançon, Les murs ont
[5] Il s’agit ici d’une citation extraite de l’ouvrage de Lénine, L’Etat et la Révolution, plus précisément de la conclusion du chapitre qui analyse l’expérience de la Commune de Paris. Rappelons pour mémoire que Lénine fait, dans cet ouvrage, de la « dictature du prolétariat » la forme de l’Etat révolutionnaire.
[6] Pierre Nora, « L’événement monstre », Communication, n°18. Pierre Nora souligne en effet que « Toutes les formes cohabitèrent pour constituer l’événement lui-même : parole des leaders et parole anonyme, parole murale et parole verbalisée, parole étudiante et parole ouvrière, parole inventive ou citative, parole politique, poétique, pédagogique ou messianique, parole sans paroles et parole bruit. L’événement est devenu intimement lié à son expression », cité par Jean-Pierre Le Goff, Mai 68, l’héritage impossible, Paris, La Découverte, 2002, p. 73.
[7] Décédé en mai 2004, le doyen Jean Schneider avait été à la faculté des Lettres titulaire de la chaire d’Histoire du Moyen Age. Il occupa la fonction de doyen pendant douze années, au cours desquelles il présida à la construction de la faculté au centre ville.
[8] Kristin Ross, op. cit., p. 35.
[9] On opposera cette dernière à la conception weberienne de l’Etat : « monopole de la violence légitime ».
[10] L’Est Républicain, 29 mai 1968. La faculté des Lettres est occupée par les étudiants à partir du 28 mai. Ce sont des membres du G.L.E.M qui sont à l’origine de cette action, tout comme l’occupation de
[11] Jean-Pierre le Goff, op. cit., p. 89.
[12] Jean-Franklin Narodetzki, Mai 68 à l’usage des moins de 20 ans, Actes Sud, 1998, p. 37. Membre fondateur du mouvement du 22 mars, J.-F. Narodetzki a rassemblé dans cet ouvrage, à l’occasion du trentième anniversaire de mai 1968, une série de slogans, de tracts et de chansons relatifs à cette période.
[13] Journal Radio F.L.N, Faculté des Lettres de Nancy, journal « bête mais pas méchant », 8 p., ici p. 3.
[14] Bernard Brillant, Les Clercs de 68, Paris, P.U.F, 2003, p. 505.


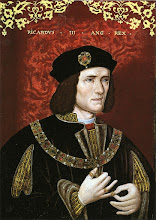
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire