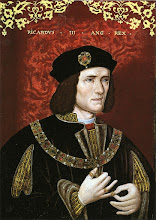Suite du témoignage de Guy Charoy, après sa découverte de la politique et ses premiers engagements, Guy s'est lancé dans la "vie active" comme instituteur. Il nous raconte cette semaine sa mutation à Badonviller où il s'ennuie ferme mais en profite pour lire et continue à "barbouiller".

Badonviller... Depuis trois mois. Nommé là à mon retour d’Allemagne. Impossible de récupérer mon poste de Varangéville. Terminé le travail d’instit en classe primaire. Nommé au Cours Complémentaire de Badonviller pour enseigner l’allemand.
Badonviller... Fin fond de la Lorraine, limite des Vosges. Badonviller cul-de-sac. Un bus pour garder le lien avec la civilisation, avec Lunéville. Et pas tous les jours. Badonviller terminus. Ensuite, demi-tour. Ou alors, passer le col de la Chapelotte, puis le Donon et descente sur Schirmeck, direction Strasbourg. Badonviller, mon Guernesey sans le génie (1).
Je suis logé dans les bâtiments scolaires que je ne quitte guère. Une vie d’ermite succède à la vie aventureuse et tumultueuse en Teutonie. Je ne quitte mon antre que pour acheter les clopes, le pain, les pâtes, les flocons d’avoine et les pommes du repas du soir. Pour accompagner le matin dès sept heures et quart et le soir jusqu’à six heures et demie les enfants dans le car, une semaine par mois, lorsque je suis de service. Les autres jours, je me lève au grincement des freins du car de ramassage qui stoppe à quelques mètres de ma fenêtre.
Mon appartement se compose de deux pièces : deux glacières. Le matin, j’ai juste le temps de sauter dans mon pantalon, d’avaler un bol d’eau que je fais chauffer sur mon réchaud à gaz butane, de me passer les mains dans les cheveux pour plaquer les épis éventuels de la nuit. Je bois mon thé debout, le bol dans une main, le rasoir électrique dans l’autre. Je n’ai pas la fraîcheur du gardon quand, dix minutes plus tard, je me retrouve devant les élèves de la première heure. À midi, je mange à la cantine avec mes collègues et les enfants. Je n’allume mon fourneau à fuel qu’à la fin de ma journée. Deux heures pour tempérer les pièces aux plafonds à quatre mètres. Je peux ôter une pelure quand j’engloutis sans guère mastiquer les raviolis tièdes que je pique à la fourchette direct dans la boîte ou les flocons d’avoine cuits dans trois quarts de litre de lait avec des raisins secs que je pioche à la cuillère direct dans la casserole.
Je m’adonne à nouveau à mes activités de barbouilleur, activités que j’avais abandonnées depuis mon retour d’Allemagne. Je passe des heures à patauger dans les couleurs à l’huile, à en tartiner les toiles et les feuilles de bristol. Et c’est le supplice, lorsque, sous l’eau courante, je frotte chacun de mes doigts à la brosse à ongles. Je m’étonne que des stalactites de glace ne pendent pas à l’unique robinet au-dessus de l’évier. L’eau froide me bloque les articulations. Le matin, au réveil, les articulations ont doublé de volume et je peux à peine bouger les phalanges. Barbouiller et lire. Mes deux occupations. Le samedi, en début d’après-midi, les courses du week-end et je ne sors plus de ma tanière avant le lundi.
Pourquoi ce long préambule ? Et mai 68 ?Je cherche seulement à te dire dans quel état d’esprit, je pouvais être dans les années qui ont suivi mon retour d’Allemagne. J’avais vingt-quatre ans. Je vivais reclus. Je n’étais au fait des
événements que par l’intermédiaire du transistor acheté à Kiel qui me tenait compagnie à longueur de temps passé dans mes deux pièces.
Le meilleur devait cependant m’arriver à Badonviller : la rencontre de Marie France. Et tu vois, j’avais bien fait d’attendre la bonne personne. François n’aurait jamais été François et toi, tu ne serais pas là !

Les Békawés
Au cours de l’année 1962, je retournais, de temps à autre, le jeudi à Nancy où je retrouvais les Békawés qui étaient des amis de ma soeur Dany. De longues heures au "Carnot", une brasserie près de la fac qui alors était de lettres et de droit. En face du Carnot se trouvait "l’Aca". Par une sorte d’accord tacite, "le Carnot" était “réservé” aux étudiants de lettres, plutôt de gauche, et "l’Aca" aux étudiants de droit, plutôt de droite.
Assis sur les banquettes du Carnot, face à une bière ou le plus souvent un café servi dans une petite tasse octogonale vert bouteille, six à huit jeunes garçons et deux ou trois filles d’une vingtaine d’années à peine pour certains, Claude, Marie, le grand et le petit Griff, le Bob, le Belge, Nofal, Georges et quelques autres, discutaient, s’engueulaient, plaisantaient. Ils refaisaient le monde, ou plutôt ils construisaient un monde nouveau. De temps à autre, l’un d’eux appelait “la Juju”, une serveuse boulotte, robe noire, tablier blanc et un énorme nœud dans les cheveux, tout droit sortie d’une gravure de Hansi (2), pour un autre petit noir bien serré.
Marx, Lénine, Gramsci et bien d’autres dont je n’avais jamais entendu parler. J’étais impressionné et tentais de suivre le discours politique de ces anciens khâgneux dont certains poursuivaient des études littéraires, de philosophie ou de sociologie.
Faulkner, Fitzgerald, Gombrowicz, Henry Miller, mais aussi Beaudelaire, Artaud, Maïakovski, Bataille, les surréalistes.
J’écoutais, je notais mentalement. Je découvris aussi que la bande dessinée avait aussi son charme pour ces garçons et Nofal accepta un jour de me prêter ses Lucky Luke.
Jourdheuil parlait de Brecht. Il se clarifiait les idées à nos dépends. De la confusion naîtrait la clarté.
Même au flipper, je ne parvenais pas à rivaliser.Deux ou trois ans plus tard, Marie France et moi, nous retrouvions le groupe au Piroux, bistrot non loin de la gare, qui faisait partie du pâté de maisons aujourd’hui détruit pour permettre à des promoteurs de construire les deux tours près de la gare. Un jour, toute la bande descendit la rue Stanislas, tenant toute la largeur, imitant les avions. J’avais quelques inquiétudes pour Marie France enceinte de plusieurs mois de François...
Guy Charoy
Notes :
(1) Les amateurs d'histoire et de littérature que vous êtes auront compris l'allusion à l'exil de Victor Hugo à Guernesey sous le Second Empire.
(2) Hansi (1873-1951)est un célèbre illustrateur alsacien
La semaine prochaine, la suite de 68 raconté à mes petits-enfants avec le quatrième épisode :
"Pendant ce temps... UEC et UJC (ML)"Les autres épisodes de notre série sur Mai 68 à Nancy :
- 1. Mars 1968 à Nancy : les prémices de mai ? (J. Pozzi)
- 2. Les tracts de mai : des vecteurs d’une provocation ciblée (J. Pozzi).
- 3. Les lycées en ébullition
- 4. Les affiches : le vecteur privilégié des provocations étudiantes (J. Pozzi)
- 5. La parole se libère à la salle Poirel, "l'Odéon" lorrain (témoignage de Stéphane Tencer et documents)
- 6. Des photographies inédites (Fac de médecine, Salle Poirel,...) (J.-L. Wagler)
- 7. Retour à la normale...
- 68 raconté à mes petits-enfants (1) Découverte de la politique et engagement (Guy Charoy)
- 68 raconté à mes petits-enfants (2) Dans la "vie active" (Guy Charoy)
- 68 raconté à mes petits-enfants (3) Solitude et barbouille (Guy Charoy)
- 68 raconté à mes petits-enfants (4) Pendant ce temps... UEC et UJC (ML) (Guy Charoy)
- 68 raconté à mes petits-enfants (5) Garde Rouge à Nancy (Guy Charoy)
- 68 raconté à mes petits-enfants (6) Théorie Pratique Théorie (Guy Charoy)
- 68 raconté à mes petits-enfants (7) Manif' minimale (Guy Charoy)
- .....